Un nouveau livre remet en question les anciens paradigmes sur la signification du temps et du travail.
L’un des graphiques les plus tristement célèbres de la macroéconomie moderne est cette comparaison de la productivité et des salaires depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Dans les décennies qui ont suivi 1945, les salaires ont augmenté parallèlement à la productivité, à mesure que l’économie se modernisait et devenait plus efficace.
Mais depuis la fin des années 1970, les deux lignes du graphique productivité-salaire ont radicalement divergé. La productivité a continué à croître à un rythme soutenu, mais les revenus ont stagné.
Pour la génération d’Européens qui a grandi dans cette économie aux revenus stagnants, le travail n’a pas apporté la vie qu’on leur avait promise (c’est-à-dire étudier dur et obtenir un emploi sûr pour pouvoir s’offrir une maison, une vie agréable et des économies pour la retraite). Ces dernières années, plusieurs ouvrages, dont ceux d’Anne Helen Petersen et d’Emily Guendelsberger, ont relaté l’expérience de générations Y qui ont rejoint le marché du travail pour constater que le contrat social dont bénéficiaient leurs parents ne s’appliquait plus à eux.
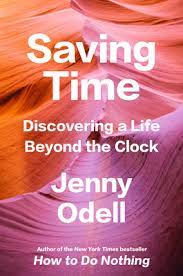
L’ouvrage de Jenny Odell, Saving Time, qui aborde le burn-out générationnel et les luttes du travailleur contemporain avec une intention philosophique, est un ajout récent et convaincant à ce corpus.
« Je doute que le burnout ait jamais été uniquement lié au fait de ne pas avoir assez d’heures dans le jour », écrit Odell.
« Ce qui semble d’abord être un souhait d’avoir plus de temps peut s’avérer n’être qu’une partie d’un simple, mais vaste, désir d’autonomie, de sens et d’objectif.
Odell, qui a notamment publié le best-seller How to Do Nothing : Resisting the Attention Economy, affirme que nous avons perdu tout sens et toute raison d’être parce que notre façon de concevoir le temps a été détournée par le travail au sein d’une société hypercapitaliste.
Elle estime que nous vivons désormais « sur la mauvaise horloge ». Qui plus est, lorsque nous bridons ce destin économique, nous cherchons invariablement de l’aide au mauvais endroit, en nous tournant vers l’industrie de l’auto-optimisation et les « frères de la productivité » qui colportent des conseils sur la façon d' »écraser vos objectifs », de découper votre jour en tranches de minutes et de conserver une concentration digne d’un laser. « Cette approche correspond parfaitement à la vision néolibérale du monde de la concurrence totale », écrit Odell.
Elle n’est pas non plus convaincue par l’autre extrémité de l’échelle : l’industrie artisanale des livres et des cours qui prônent le ralentissement pour se réapproprier sa personne et sa créativité. « Tant que la lenteur est invoquée simplement pour faire tourner plus vite la machine du capitalisme, elle risque de n’être qu’une solution cosmétique », écrit-elle.
Karl Marx a été le premier à observer que le capital « libère le temps afin de se l’approprier ». Odell affirme que nous considérons les congés comme une occasion de nous préparer à être très performants dès la reprise du travail. Elle cite l’exemple des centres de villégiature de luxe qui proposent des programmes de bien-être exigeant des clients qu’ils se fixent des objectifs pour leur séjour et qui surveillent leur sommeil, leur alimentation et leur circulation sanguine.
Pour Odell, même la pratique consistant à documenter les activités de vacances et de week-end sur les réseaux sociaux renforce la notion que les loisirs doivent encore impliquer de faire quelque chose plutôt que de simplement « être » ou de s’éteindre complètement. Faisant un clin d’œil au travail du philosophe du XXe siècle Josef Pieper, Odell préfère considérer les congés comme une occasion d’entrer dans un état d’esprit différent, « un état qui, comme l’endormissement, ne peut être atteint qu’en se laissant aller ».
Les Générations Y ont rejoint la population active pour constater que le contrat social dont bénéficiaient leurs parents ne s’appliquait plus à eux.
Dans ce qui constitue peut-être la meilleure partie de Saving Time, Odell tombe sur une « caractérisation très précise et embarrassante » de sa propre vie dans un article universitaire. Le sociologue Hartmut Rosa décrit la vie et les habitudes d’un professeur fictif nommé Linda. Linda a un emploi et des moyens, mais elle se sent chroniquement occupée, « toujours à court et en retard » par rapport à ses différents engagements. Il est possible d’être véritablement prisonnier d’un manque de temps – il y a ceux qui doivent cumuler plusieurs emplois pour payer le loyer tout en élevant leurs enfants – mais Rosa soutient que la situation difficile de Linda est auto-générée. Selon l’analyse d’Odell, Linda se considère comme « contrôlée et surveillée » par la société qui attend d’elle qu’elle soit occupée et productive à tout moment, par ce que Rosa appelle proprement la « logique de l’expansion ». Ce concept a été si profondément enraciné qu’il a été adopté même par ceux qui disposent d’une grande marge de manœuvre.
Cette analyse est contenue dans la première moitié de Saving Time, qui est un véritable feu d’artifice. Dans la seconde moitié, Odell réfléchit à d’autres aspects de notre relation au temps, y compris une longue réflexion sur la crise climatique (qui, selon elle, est si difficile à traiter parce qu’elle se déroule sur un plan plus long et plus lent), et les leçons tirées par ceux qui, comme les handicapés et les détenus, sont empêchés d’avoir la même relation au temps que le reste de la société.
Odell est catégorique : pour ceux d’entre nous qui ont les moyens d’échapper à « l’illusion de la pression temporelle » qui a capturé Linda, le rejet doit être total, « l’ego tourné vers l’avant qui s’accroche au temps doit mourir ».
Ce n’est pas facile, et sa suggestion de ce qui pourrait remplacer cet état de fait, être « plus vivant à chaque instant – un mouvement vers l’extérieur et à travers, plutôt que d’avancer sur une piste étroite et solitaire », pourrait provenir de la méditation.
La lecture de Saving Time vaut l’investissement pour l’excoriation par Odell de l' »industrie de la productivité » et l’ironie au cœur de celle-ci, d’une « vie consommée par l’effort de faire plus d’elle-même ».
